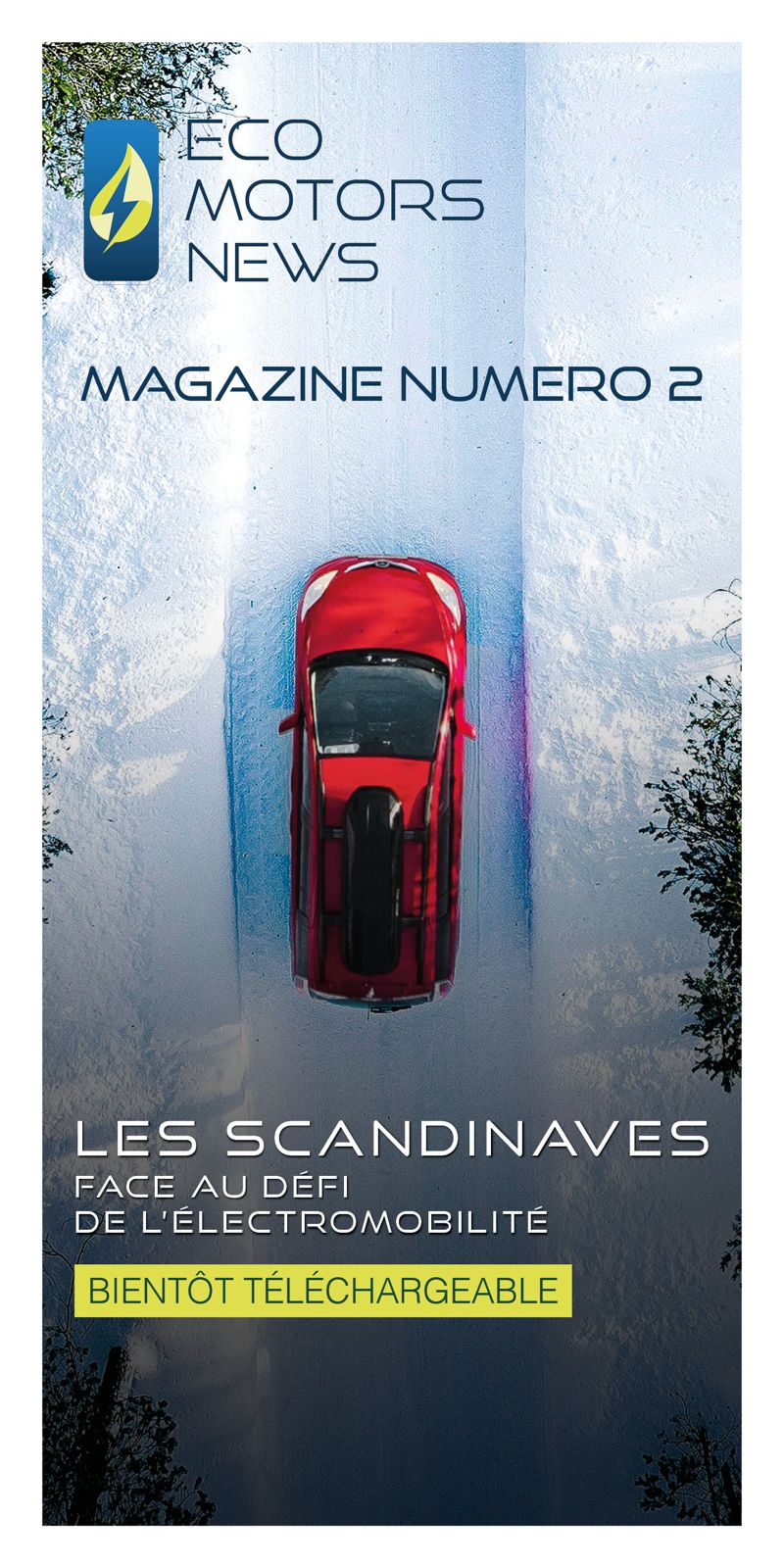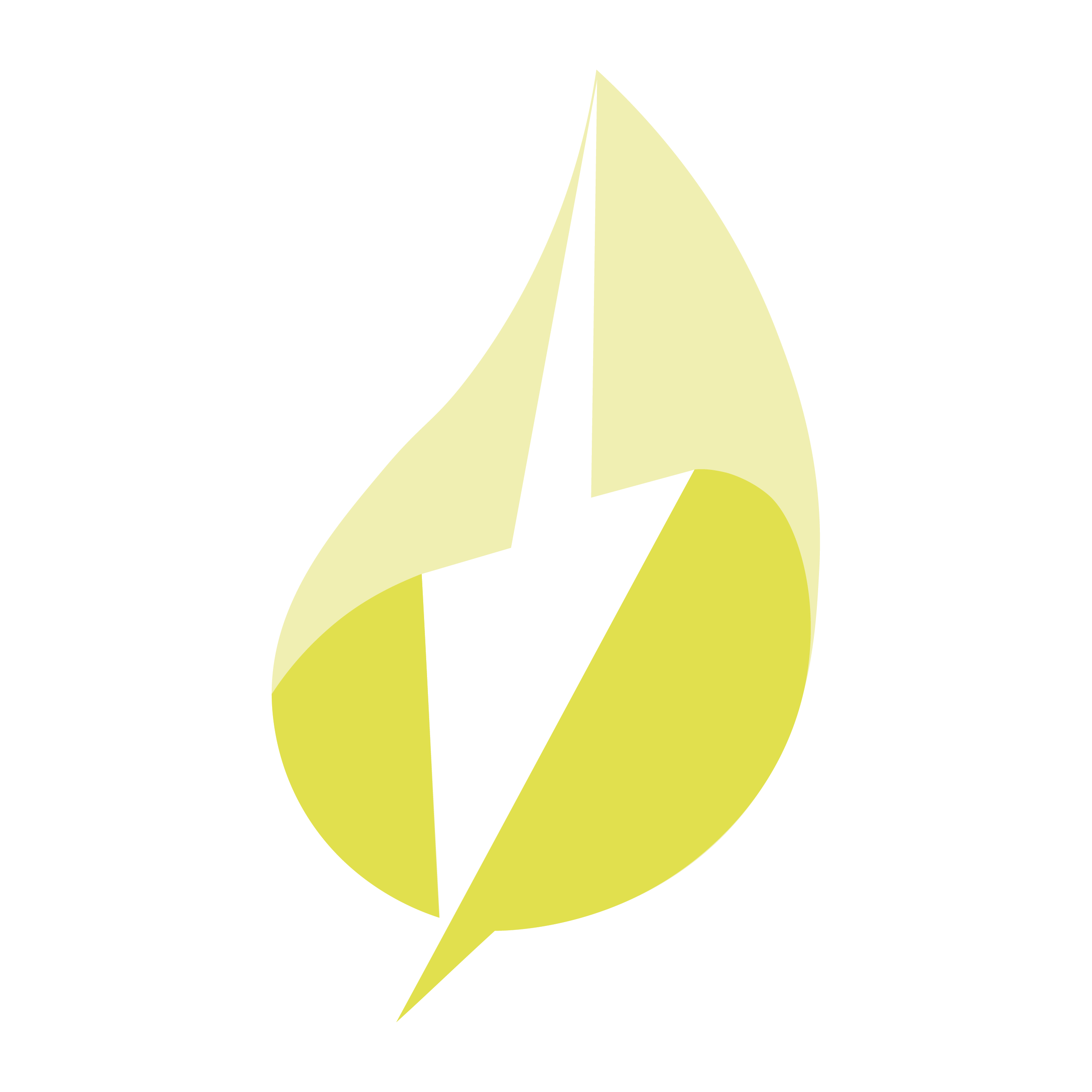Dans un contexte de transition énergétique urgente, les capitales européennes accélèrent leur engagement pour l’électromobilité. Elles misent sur les voitures électriques, les hybrides et les infrastructures de recharge. Berlin, Luxembourg-Ville, Madrid et Lisbonne illustrent quatre approches différentes, mais ambitieuses. Chaque ville affiche des objectifs forts et affronte des défis précis. Urbanisme, financement et infrastructure constituent leurs principaux enjeux à court terme.

Berlin : une métropole allemande en plein virage
La capitale allemande multiplie les initiatives pour électrifier ses véhicules et développer un vaste réseau de bornes de recharge. Au 1ᵉʳ janvier 2025, Berlin comptait environ 80 000 voitures électriques immatriculées et près de 35 000 bornes installées dans la ville. Parmi elles, plus de 5 000 étaient accessibles au public, selon les données municipales. Ce développement s’inscrit dans une stratégie globale pour répondre à la hausse de la demande en électricité. L’opérateur Stromnetz Berlin prévoit une capacité de 4,5 GW en 2035, contre 2 GW seulement en 2024. Le gouvernement fédéral soutient cet effort par un plan de 6,3 milliards d’euros pour renforcer les infrastructures. L’objectif est ambitieux : atteindre un million de points de recharge en Allemagne d’ici à 2030. « Berlin est un pionnier de l’électromobilité. Grâce à une bonne mise en réseau entre la politique, la science et les entreprises. » dit Kai Wegner, maire de Berlin.
Malgré ces progrès, l’essor de l’électromobilité se heurte encore à certaines contraintes : l’essentiel des bornes de Berlin sont situées en zones privées (domicile, entreprises), soit environ 80 % selon les autorités, et l’extension vers des zones très denses reste un frein.
En termes d’ambiance, cette dynamique traduit une prise de conscience urbaine : la mobilité électrique est présentée non seulement comme un levier de qualité de vie (réduction des émissions, du bruit), mais aussi comme un potentiel de croissance pour les acteurs de la mobilité.
En revanche, l’interconnexion des infrastructures, notamment dans les copropriétés ou immeubles partagés, demeure un chantier majeur à Berlin.

Luxembourg-ville : petit pays, grandes ambitions
La capitale du Grand-Duché et son agglomération affichent un objectif ambitieux : électrifier 49 % du parc automobile d’ici à 2030. Cette ambition s’accompagne de mesures concrètes pour soutenir le déploiement de bornes. En juin 2025, un appel d’offres a attribué une concession de sept ans à un groupement privé pour installer le réseau de recharge. Le pays propose aussi des aides ciblées aux entreprises, couvrant jusqu’à 50 % du coût pour installer des bornes publiques ou professionnelles. Ces bornes peuvent atteindre des puissances d’au moins 175 kW pour répondre aux besoins des utilisateurs. Le dispositif « Stroum beweegt » rassemble plus de 40 acteurs publics et privés autour d’un engagement commun pour la mobilité électrique.
Malgré cela, le bilan révèle que les véhicules à essence et diesel représentent encore près de 90 % du parc total. Le défi est donc de taille : maintenir le rythme de remplacement des véhicules tout en intensifiant le maillage des infrastructures dans un territoire très dense.
L’atmosphère y est volontariste : le pays s’affiche en effet comme un laboratoire compact de mobilité durable. Ce qui lui donne un avantage relatif en matière de densité de bornes par habitant et de mesures incitatives fortes.
Madrid : l’Espagne mise sur l’infrastructure rapide
Dans la capitale espagnole, le déploiement se concentre sur des infrastructures de charge massives. Le soutien public à l’achat de véhicules électriques complète ces efforts. Le programme national de subventions MOVES III a été prolongé en 2025. Il bénéficie d’un budget supplémentaire de 400 millions d’euros pour encourager l’achat de véhicules électriques et l’installation de bornes. Côté équipements, la région de Madrid et Iberdrola España ont inauguré en juin 2025 un hub de recharge rapide. Ce hub comporte 47 bornes, dont 15 peuvent recharger 80 % d’une batterie en moins de 15 minutes.
Par ailleurs, l’entreprise de transport urbain Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid a signé un prêt de 50 millions d’euros avec la European Investment Bank pour l’achat de 250 bus électriques et 10 bus à hydrogène, ainsi que l’infrastructure correspondante.
L’ambiance à Madrid favorise le modèle grande borne rapide combiné aux subventions nationales. Le principal défi reste la couverture urbaine complète. Il faut aussi intégrer les bornes dans les zones résidentielles. Enfin, développer l’usage des véhicules électriques dans des zones denses et périphériques reste un enjeu majeur.

Lisbonne : un pas vers l’électrification intensive
La ville de Lisbonne et le Portugal montrent des signes forts de progression. En janvier 2025, les véhicules électriques à batterie représentaient 22,5 % des nouvelles immatriculations dans le pays. Au niveau des infrastructures, la société Galp a inauguré des bornes ultra‑rapides de 300 kW dans la région de Lisbonne. Comme à Berlin, une solution pilote de recharge via les lampadaires urbains a également été déployée. De plus, la société de transport public de Lisbonne, Carris, prévoit que 90 % de sa flotte soit “clean energy” d’ici à 2028. Cela correspond à environ 300 bus électriques sur l’ensemble de la flotte.
À Lisbonne, l’atmosphère montre une forte accélération, mais certaines zones restent à combler. Le nombre de bornes publiques reste modéré, mais il augmente rapidement. Le principal défi est de transformer les zones résidentielles historiques sans garage individuel. Il faut aussi améliorer la coordination entre acteurs publics et privés.
En résumé, Lisbonne combine des indicateurs prometteurs avec des obstacles typiques de villes anciennes : stationnement, patrimoine, densité.

Ce que cette comparaison révèle
En comparant ces quatre capitales, plusieurs points clés se dégagent.
- Premièrement, l’infrastructure de recharge reste essentielle. Madrid mise sur des hubs ultra-rapides, Berlin et Luxembourg sur un réseau dense, et Lisbonne sur des solutions urbaines innovantes. L’accès simple à la recharge influence fortement le choix des utilisateurs.
- Deuxièmement, les politiques de soutien financier sont incontournables. Subventions à l’achat, aides pour installer des bornes et programmes publics-privés facilitent le déploiement des véhicules électriques.
- Troisièmement, le contexte local joue un rôle important. La densité urbaine, le type de logement, le patrimoine et l’énergie disponible conditionnent la vitesse de déploiement.
- Enfin, la communication et les partenariats sont essentiels. Villes, opérateurs, fournisseurs d’énergie et industriels collaborent avec plus ou moins d’efficacité selon les cas. Berlin et Luxembourg illustrent bien ces coopérations.
Malgré ces efforts, des défis restent à relever. Il faut gérer les immeubles avec parkings collectifs, raccorder les zones denses, harmoniser les standards de recharge et intégrer hybrides et véhicules lourds. Les villes devront maintenir le rythme pour ne pas ralentir la transition.
Perspectives d’avenir
Pour les années à venir, ces quatre capitales devraient poursuivre leurs efforts. Elles vont étendre le maillage de bornes et inciter au renouvellement des flottes privées et publiques. Madrid développe les batteries échangeables et Lisbonne expérimente les lampadaires équipés de bornes. Les synergies européennes, via les fonds de l’UE ou des mécanismes transnationaux, auront un rôle important. En conclusion, l’électromobilité dépasse le simple changement de motorisation. Elle constitue un élément central de la transition urbaine, économique et énergétique.