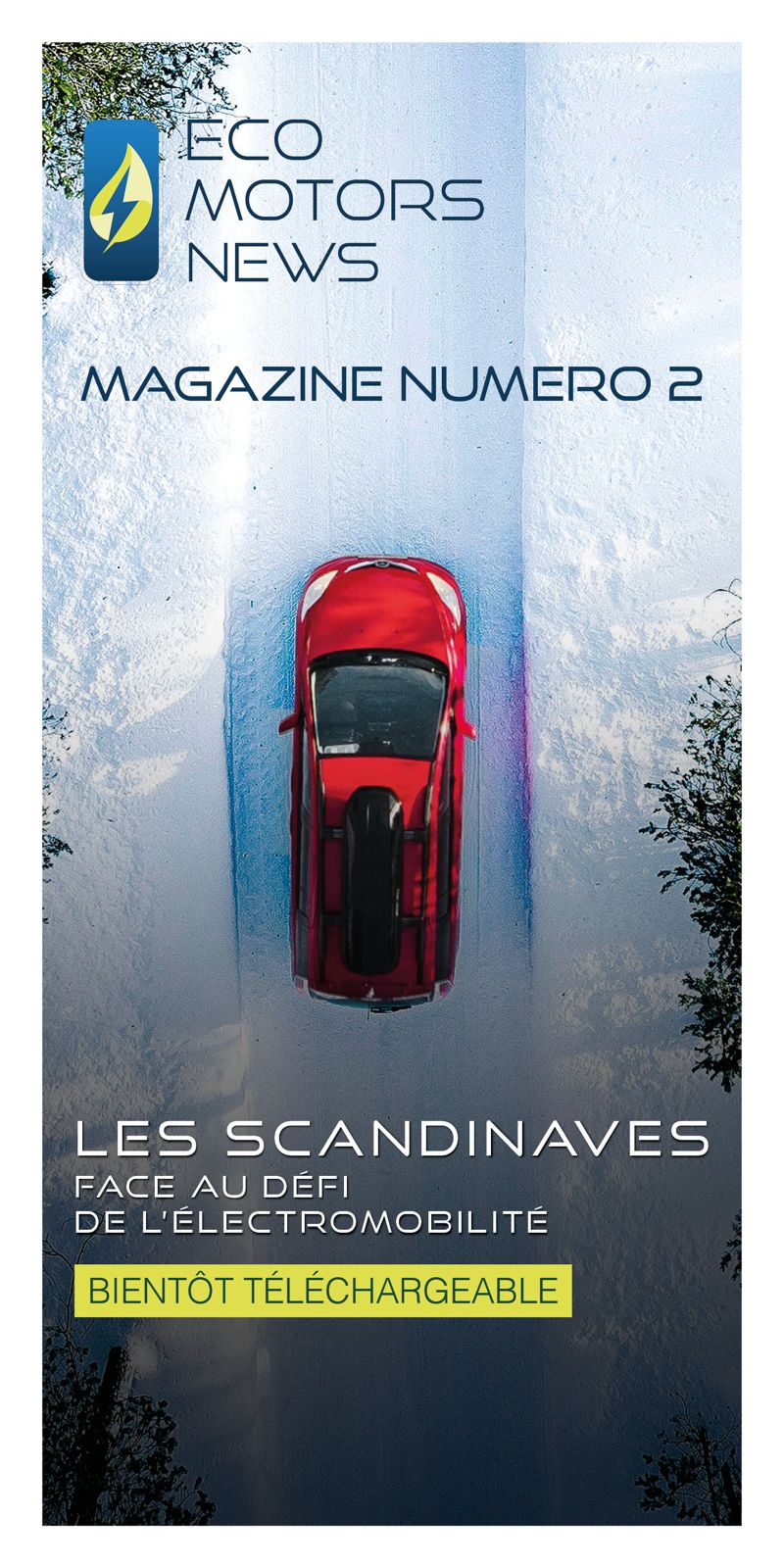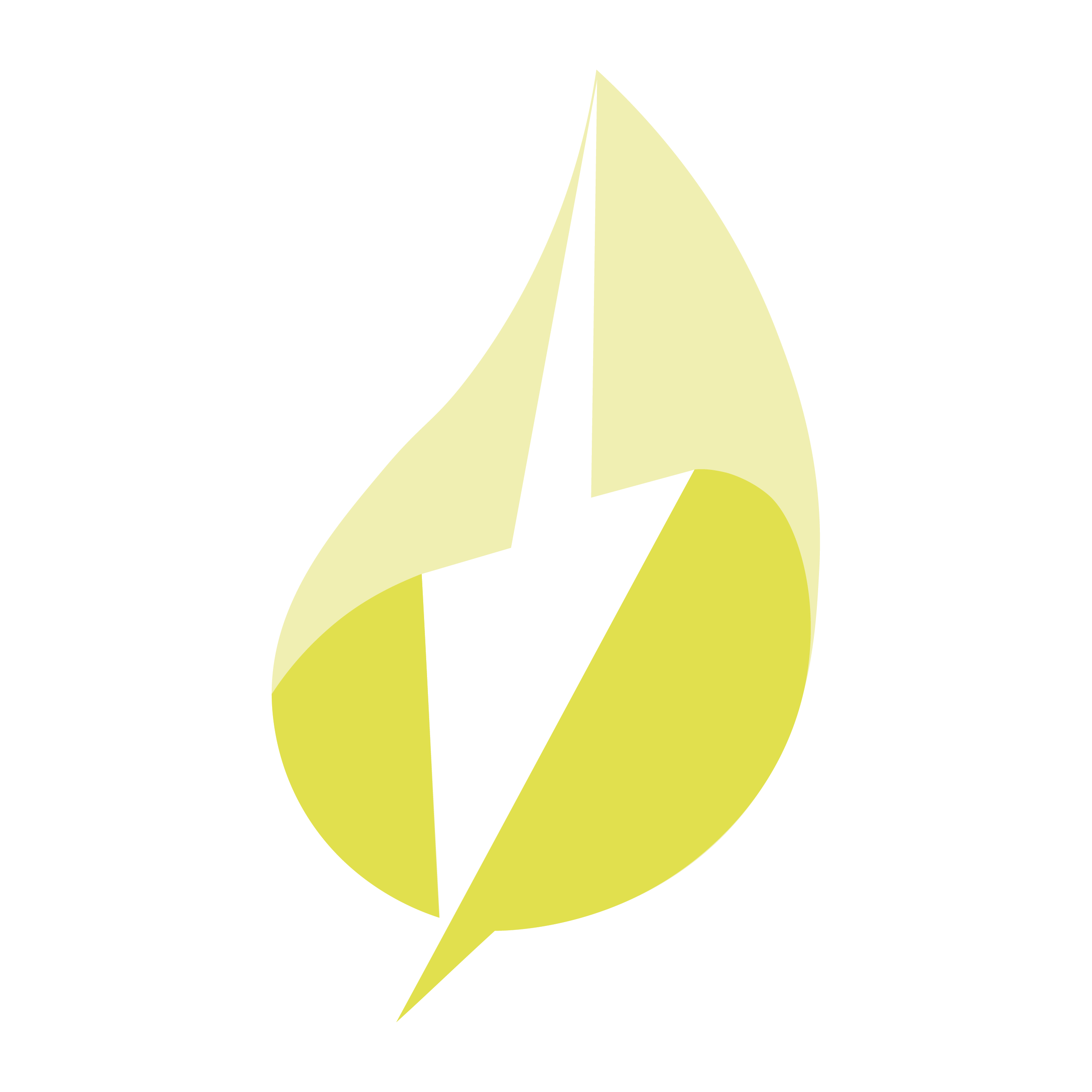À l’heure où les pays développent leurs transitions énergétiques des transports, les territoires d’outre-mer français, souvent oubliés des grands plans nationaux, sont-ils les délaissés de l’électromobilité ? Défis logistiques, mix énergétique singulier, ambitions parfois contrariées : territoire par territoire, découvrons où en est l’électromobilité au large de l’Hexagone en 2025.

La Réunion
Leader ultramarin de l’électromobilité, La Réunion affiche le taux de pénétration le plus important des territoires d’outre-mer français. Avec au total 6 005 véhicules neufs vendus au premier trimestre 2025, l’île enregistre une baisse de 8,4 % par rapport à l’an dernier. Même constat pour les véhicules électrifiés : 742 véhicules électriques vendus, soit une diminution de 32,1 %.
Dans ces chiffres, les BEV représentent 631 unités (10,5 % de part de marché), tandis que les PHEV représentent 111 unités (1,8 % de part de marché). Ces baisses s’expliquent en grande partie par la suppression de l’exonération fiscale locale et par la hausse des prix.
La densité des bornes y est également la plus élevée (462 points publics recensés), portée par des opérateurs locaux comme EZDrive. Le territoire combine un fort taux d’électrification globale (49,9 %), mais reste très sensible aux aléas économiques et politiques.
Martinique
Le territoire compte 211 bornes publiques en 2025, un chiffre en progression, mais encore insuffisant pour accompagner les automobilistes. Elles sont déployées par différents opérateurs : EZDrive, VoltDom et TotalEnergies, qui proposent des tarifs moyens compétitifs.
Le marché des véhicules électriques reste modeste (4,9 % de part de marché en 2024).
Cette faible pénétration s’explique par plusieurs facteurs :
- un réseau routier très énergivore (forts dénivelés, climatisation quasi permanente) ;
- une offre de modèles limitée et pas toujours adaptée aux contraintes locales ;
- un contexte économique et social tendu.
Guadeloupe
La Guadeloupe compte plus de 184 bornes publiques, un nombre encore faible mais en progression constante, soutenu par des acteurs comme gmob, EZDrive et TotalEnergies.

Côté ventes, les résultats sont encourageants : malgré un recul global du marché des véhicules particuliers (-6,1 % en 2024), la part des véhicules électriques atteint entre 5 et 6 %, soit une augmentation d’environ 20 %.
Au-delà de l’automobile, l’électromobilité progresse aussi dans les deux-roues : depuis quelques années, la majorité des cyclomoteurs vendus sont électriques.
EDF Guadeloupe a également lancé le projet D.R.I.V.E., une expérimentation visant à mesurer l’intérêt d’ombrières photovoltaïques dédiées à la recharge, avec pilotage intelligent favorisant les heures d’ensoleillement.
Guyane
Bien qu’elle dispose du plus vaste territoire d’outre-mer, l’électromobilité guyanaise peine à décoller. Le réseau public compte seulement 30 points de recharge, ce qui en fait le territoire le moins équipé. Cette carence constitue un frein majeur : la part de marché des BEV reste inférieure à 3 %.
Paradoxalement, la Guyane est l’un des territoires les plus avancés en matière de production électrique décarbonée grâce au barrage de Petit-Saut et à son potentiel hydroélectrique, couvrant près de 70 % des besoins en électricité.
Mayotte
Probablement le territoire le plus en difficulté, Mayotte souffre d’une forte fragilité économique. Le marché automobile est en crise, avec une chute de -12,6 % sur l’occasion en 2024, et une faible pénétration des électriques pures (à peine plus de 3 %).
Malgré cela, le taux d’électrification hybride est élevé (30,2 % en 2022). La transition est en cours, mais fortement freinée par les contraintes économiques locales.
Les données concernant l’infrastructure sont inexistantes : cette absence d’informations publiques révèle un retard significatif du territoire.
Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie a adopté en 2022 un Schéma de Transition Énergétique (STENC 2) avec un objectif clair : 18 500 véhicules électriques d’ici 2030. Le territoire a déjà progressé : environ 1 000 VE circulent, une quarantaine de bornes existent (réseau Hivy), et la première borne hypercharge 150 kW a été inaugurée en 2025.
Les aides locales soutiennent également la transition :
- prime de 600 000 francs CFP (environ 5 030 €) pour l’achat d’un VE ;
- tarif électrique préférentiel pour les bornes : 8 francs/kWh de jour et 20 francs/kWh de nuit (contre 34,96 francs pour le tarif standard).
La transition reste toutefois freinée par des facteurs culturels (fort attachement aux 4×4), économiques et politiques.

Polynésie française
Le marché est encore embryonnaire, avec seulement 2 à 3 % de parts électriques et environ 150 véhicules vendus chaque année.
Contrairement à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie n’offre aucune subvention significative, ce qui freine l’adoption.
La montée en puissance est limitée par des infrastructures quasi inexistantes, liées notamment à l’autorisation très récente (2024) d’installer des bornes payantes de plus de 3 kW.
Saint-Barthélemy & Saint-Martin
Dans ces territoires, l’électromobilité reste un mode de déplacement de niche, plutôt haut de gamme : la transition passe surtout par l’importation de modèles luxueux, souvent hybrides. Les bornes publiques sont rares et les aides locales quasi inexistantes.
Autres territoires ultramarins
À Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna, les marchés sont marginaux, voire inexistants. Sans infrastructure recensée et avec une faible densité de population, l’ensemble du marché dépend de l’import, la demande restant très faible.
Intégration dans les politiques nationales
La France métropolitaine encourage l’électromobilité depuis des années, notamment via les aides publiques. Mais, si les dispositifs nationaux (bonus écologique, leasing social) sont théoriquement ouverts aux DOM-TOM, leur application se révèle complexe.
L’État a accordé une majoration de 1 000 € du bonus pour les DROM, pouvant atteindre 8 000 € selon les ressources. En revanche, la prime à la conversion a été supprimée depuis décembre 2024 pour les particuliers.
Un crédit d’impôt de 500 € pour l’installation d’une borne à domicile est prolongé jusqu’en 2027. Le programme ADVENIR ZNI, mis en place par l’ADEME, finance jusqu’à 2 160 € par borne dans les zones non interconnectées. Il encourage notamment la recharge solaire pour éviter les pics de consommation.
Pourtant, ces aides ne rencontrent pas toujours le succès attendu : coûts logistiques élevés, prix d’importation, manque de structures de reprise, faible densité de bornes et politiques fiscales locales limitent leur impact.

Défis et atouts transversaux
Les territoires ultramarins présentent un paradoxe énergétique : forte dépendance aux énergies fossiles, mais potentiel renouvelable considérable (soleil, vent, hydroélectricité).
Le statut de zones non interconnectées entraîne un coût de production électrique pouvant être jusqu’à dix fois supérieur à celui de la métropole.
Ce contexte complique l’émergence d’une électromobilité durable, où l’optimisation de la recharge et la coordination avec les énergies locales deviennent essentielles.
S’ajoutent des contraintes socio-économiques (pauvreté, prix élevés, modèles peu adaptés) et l’usage intensif de la climatisation, énergivore pour les batteries. Pourtant, les distances réduites des îles constituent un avantage : elles en font de véritables laboratoires naturels de la transition énergétique, notamment via les mini-réseaux, les ombrières solaires ou la gestion intelligente de la recharge.
Conclusion
Si La Réunion montre la voie, avec un taux de pénétration dépassant 10 %, la transition reste très hétérogène dans les outre-mer français. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte accusent un retard, tandis qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, les ambitions existent malgré un marché encore limité.
L’intégration aux aides métropolitaines est réelle, mais leur efficacité nécessite un accompagnement différencié et un accès plus large à la recharge. La décennie 2025-2035 sera déterminante : l’enjeu est clair — faire des territoires ultramarins des leviers majeurs d’une mobilité durable.