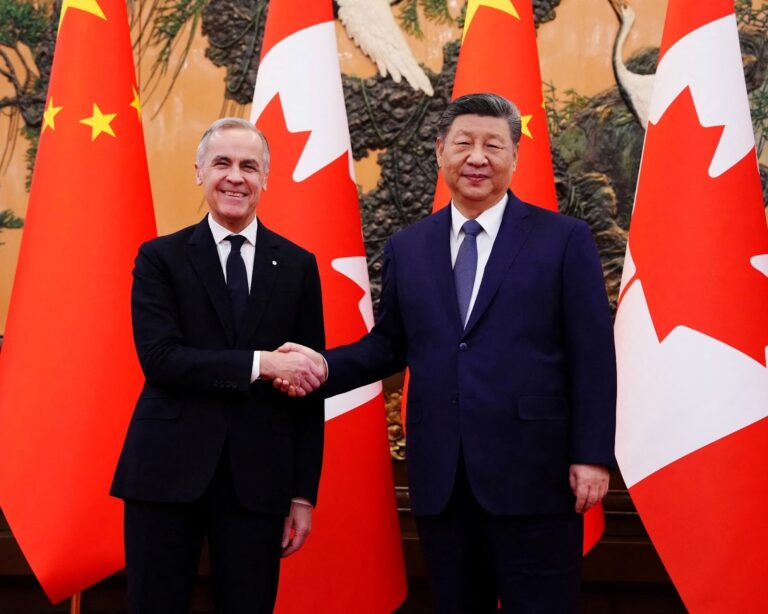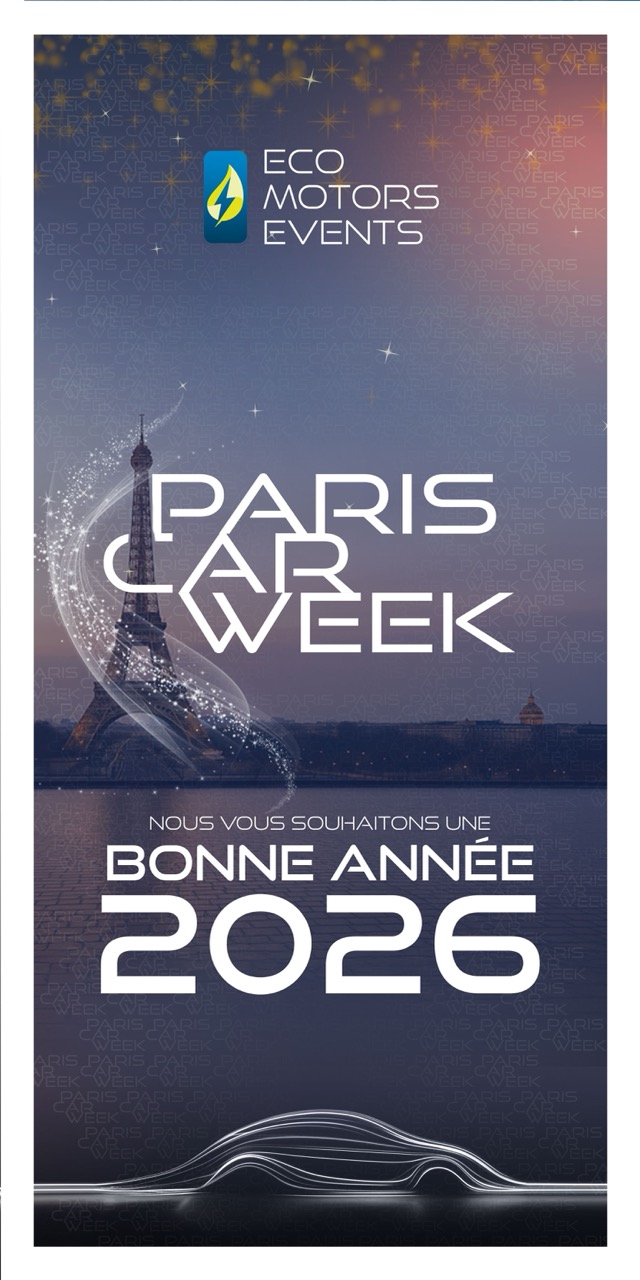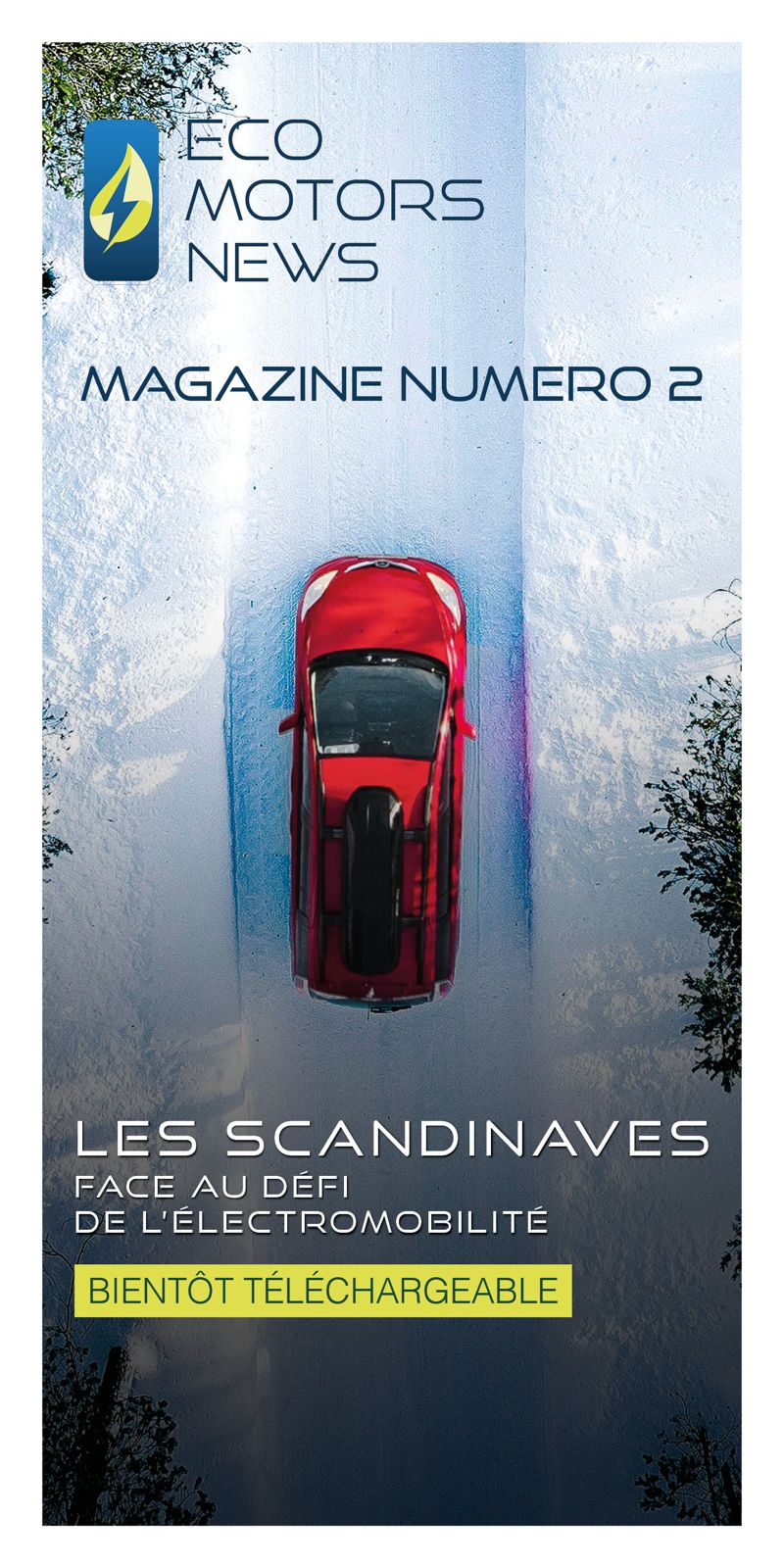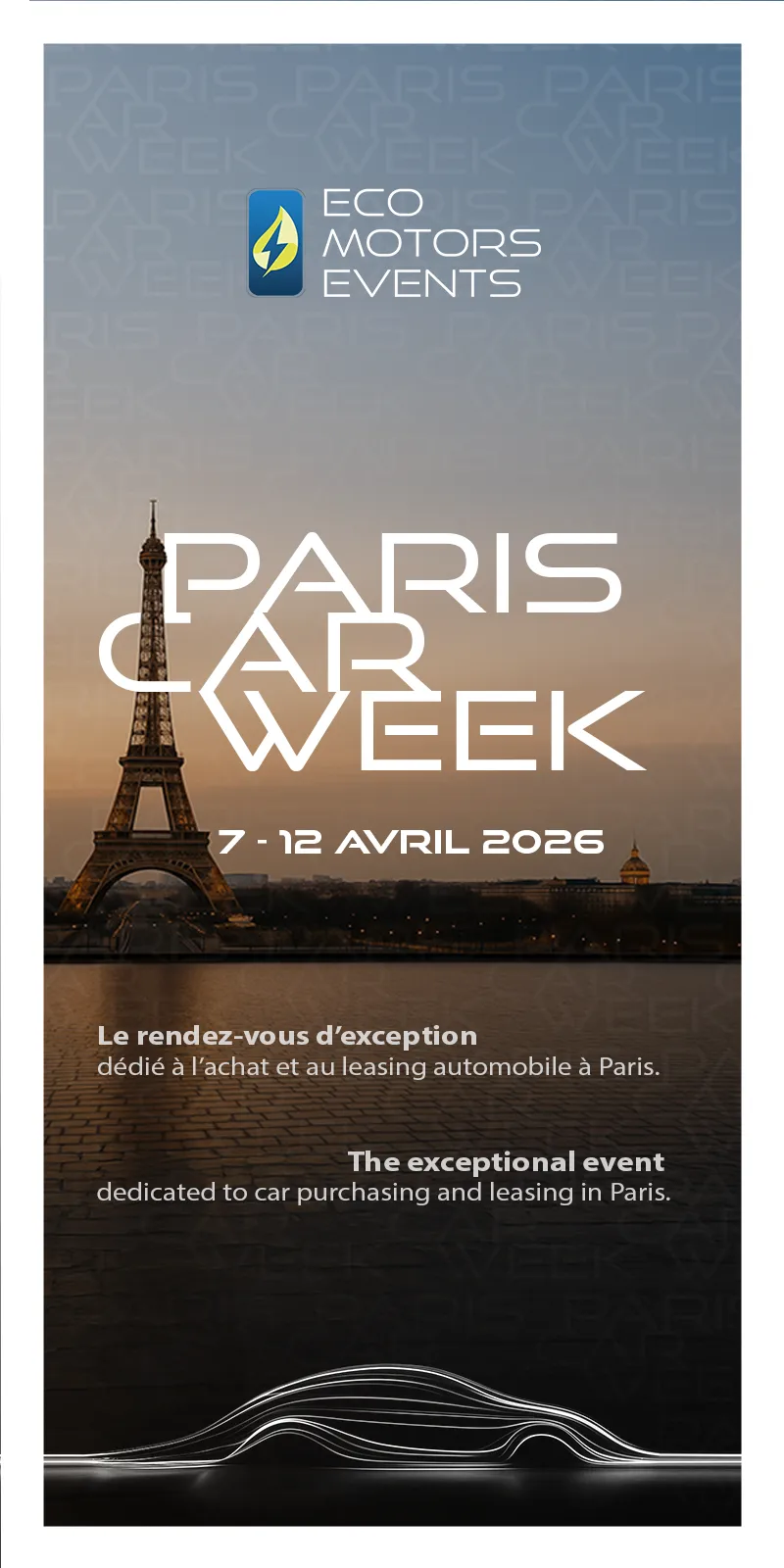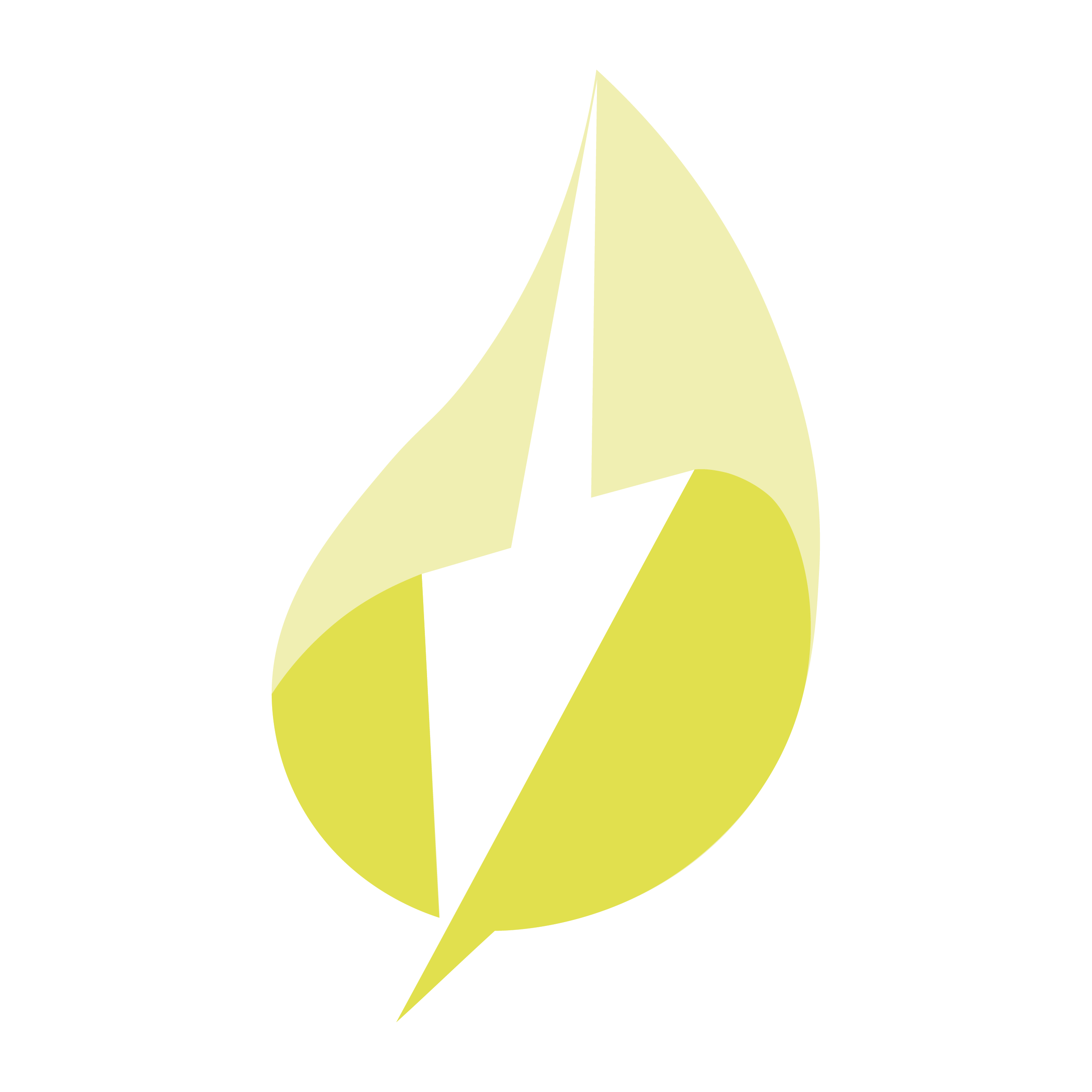La transition vers la mobilité électrique n’est plus une perspective : c’est une réalité qui s’impose à marche forcée aux constructeurs, aux consommateurs et aux États. En France, le marché des véhicules électriques (VE) progresse à un rythme soutenu. Pourtant, une question cruciale se pose : la France est-elle prête, en matière d’infrastructures, à accompagner ce bouleversement ? Et peut-elle rivaliser avec les leaders européens ou asiatiques en matière de compétitivité industrielle et d’innovation ?

Le défi de la recharge : entre promesses et réalité
Le déploiement de bornes de recharge est l’un des nerfs de la guerre. Le cap des 155 000 bornes annoncées pour fin 2024 marque une hausse de 31 % en un an. Mais le franchissement tardif du seuil des 100 000 bornes, avec plus de deux ans de retard, révèle les difficultés structurelles rencontrées.
Si la France figure parmi les trois pays les mieux dotés en Europe, cette dynamique masque de fortes disparités territoriales. Près de 80 % des points de recharge sont concentrés dans les grandes métropoles, laissant les zones rurales dans une situation de désert électrique. La Cour des comptes alerte sur une inégalité d’accès aux IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique), qui limite la confiance des utilisateurs et freine la transition. Elle fait part également de la « difficulté à parvenir à un maillage équilibré et adapté aux besoins réels des utilisateurs » lié au fait que « les zones, généralement urbaines, les plus dotées en IRVE sont aussi celles où existe le parc de véhicules électriques le plus fourni ».
Le modèle économique des bornes publiques inquiète : coûts d’installation élevés (jusqu’à 50 000 € par borne rapide), taux d’utilisation irréguliers, et réticence des opérateurs à investir sans rentabilité assurée. Dans de nombreuses villes moyennes, moins de 10 bornes sont disponibles pour 100 000 habitants. À l’inverse, les Pays-Bas et l’Allemagne bénéficient d’un maillage plus dense, soutenu par des politiques publiques fortes.
Autre point critique : la puissance des bornes installées. Si le nombre de points de recharge augmente, la part des bornes dites « rapides » (plus de 150 kW) reste minoritaire. Or, pour convaincre les automobilistes réticents à passer à l’électrique, la possibilité de recharger rapidement lors d’un long trajet est un argument clé.
Ainsi, au-delà des disparités géographiques, plusieurs défis pèsent sur la viabilité économique des acteurs du secteur : la flambée des coûts énergétiques, les ajustements des aides publiques et les fluctuations du marché des véhicules électriques. Autant d’éléments qui fragilisent les modèles économiques en cours d’élaboration.
Dans ce contexte encore mouvant, la filière des IRVE est en phase de maturation. Pour garantir son essor, une concurrence équilibrée doit s’instaurer, encourageant à la fois l’innovation et les investissements privés.
La France à la croisée des chemins
Le développement des infrastructures ne repose pas seulement sur l’investissement public, mais sur la mobilisation de l’écosystème industriel et énergétique. La France bénéficie d’un mix énergétique décarboné, d’une industrie automobile encore solide, et d’acteurs engagés.
Mais plusieurs freins persistent. Le premier est administratif : projets ralentis par les lourdeurs, retards de raccordement ou blocages locaux. Des progrès ont été faits via les plans « France Relance » et « France 2030« , mais leur mise en œuvre reste inégale.
Le second défi est économique : dans les zones peu fréquentées, la rentabilité des stations est incertaine, et les opérateurs hésitent à investir là où les aides diminuent.
Enfin, la fiabilité des bornes reste problématique. Certaines zones affichent un taux de disponibilité inférieur à 80 %, nourrissant la défiance du public.
Compétitivité industrielle : la bataille des batteries
Derrière les questions de bornes et de bonus, une autre bataille s’engage : celle de l’industrie. Et elle se concentre sur un élément central : la batterie.

Sans sa maîtrise, il est impossible de capter la valeur ajoutée du véhicule électrique. Longtemps absente de ce segment, la France a réagi. À Douvrin, dans le Pas-de-Calais, les premières lignes de production d’ACC (coentreprise entre Stellantis, TotalEnergies, Mercedes-Benz) a ouvert ses premières lignes. D’autres projets suivent : Verkor à Dunkerque dans le Nord, avec le soutien de Renault, ou encore le Taïwanais ProLogium qui a choisi, lui aussi, le nord de la France pour y implanter une de ses usines. Ces projets représentent plusieurs milliards d’euros d’investissement. Et l’objectif est clair : produire, d’ici à la fin de la décennie, des centaines de milliers de batteries chaque année.
Ces « gigafactories » incarnent une volonté de changement d’échelle et de souveraineté, face à la domination asiatique. Elles cherchent aussi à sécuriser l’approvisionnement en cas de tensions géopolitiques. Mais tout reste à bâtir : savoir-faire, chaînes de valeur, et surtout, accès aux matières premières comme le lithium ou le cobalt, souvent extraits loin et dans des conditions discutables.
Former, adapter, ne pas subir
Le passage à l’électrique transforme toute la filière. Plus de pistons, moins d’huile. Plus d’électronique, moins de mécanique.
Selon l’Observatoire de la métallurgie, plus de 100 000 emplois pourraient être concernés d’ici à 2035, non pas supprimés, mais reconfigurés. Le risque, c’est que la transition laisse des salariés sur le bord de la route.
Des dispositifs existent : formations régionales, CFA spécialisés, requalification interne. Mais le défi est colossal. Former un technicien batterie ou un ingénieur logiciel ne se fait pas du jour au lendemain.
Et les tensions sont déjà visibles. Dans les gigafactories, les recruteurs manquent de profils prêts à répondre à la montée en puissance.

Une course mondiale, une réponse européenne
La France n’est pas seule. Elle s’inscrit dans un jeu à plusieurs niveaux, où l’Europe tente de défendre ses positions face à des géants bien armés. La Chine, en avance sur tous les maillons – extraction, raffinage, recyclage – domine la chaîne. Les États-Unis, avec leur Inflation Reduction Act (IRA), misent sur des aides massives pour relocaliser leur industrie verte.
L’Europe avance par étapes : Pacte vert, appels à projets, subventions. Mais sa réponse reste souvent trop lente, trop fragmentée. La France milite pour une stratégie industrielle européenne, fondée sur l’innovation, la montée en gamme et la coopération. Des alliances avec l’Allemagne ou l’Espagne seront déterminantes pour faire émerger des champions.
Car au-delà des normes et des plans d’investissement, c’est une question de souveraineté : produire ses véhicules, ses batteries, ses logiciels. Ne pas dépendre d’un autre continent pour faire rouler ses voitures.
Un moment charnière
La transition électrique est en marche. Les constructeurs accélèrent, les ventes suivent, l’opinion évolue. Mais derrière la vitrine commerciale, une transformation profonde s’opère : celle d’un tissu industriel à reconstruire.
C’est une course contre-la-montre. Rien ne garantit qu’elle sera gagnée. Mais elle est vitale pour la compétitivité de l’automobile française, pour l’emploi, et pour éviter de devenir simple consommateur de technologies importées.