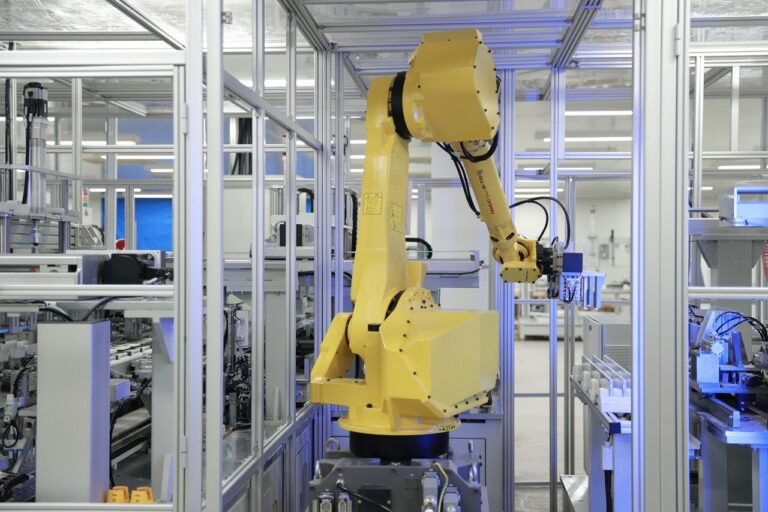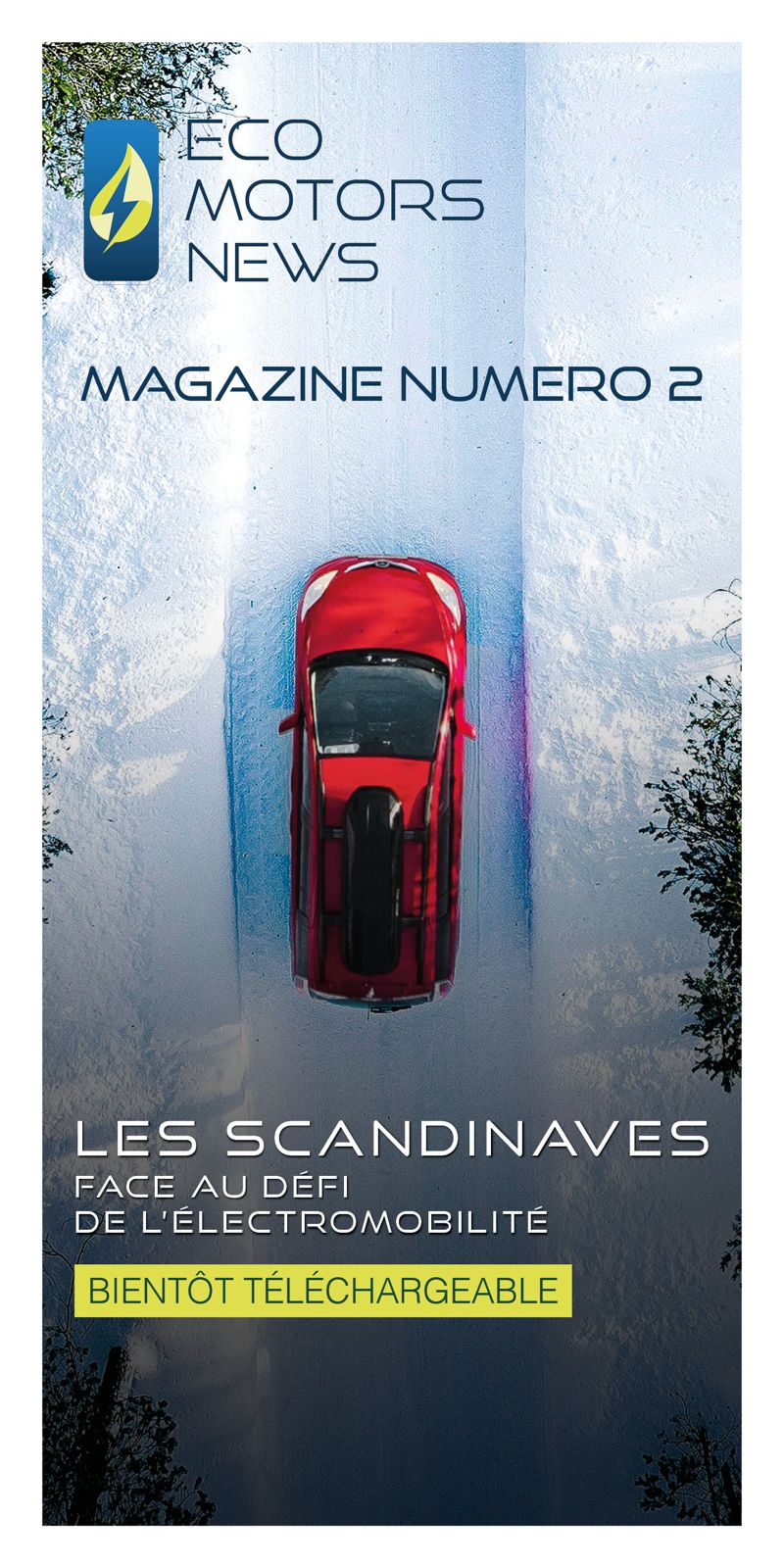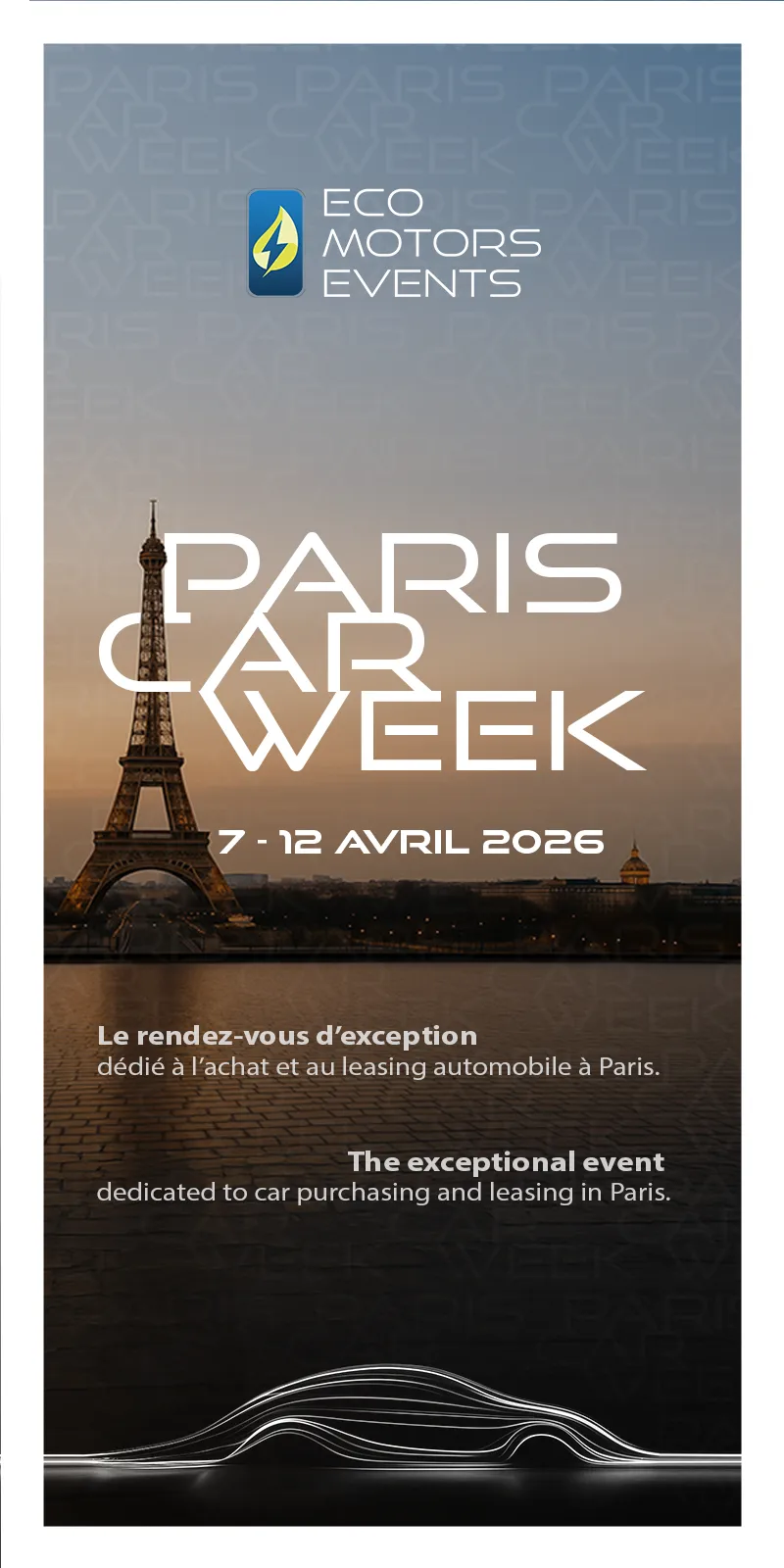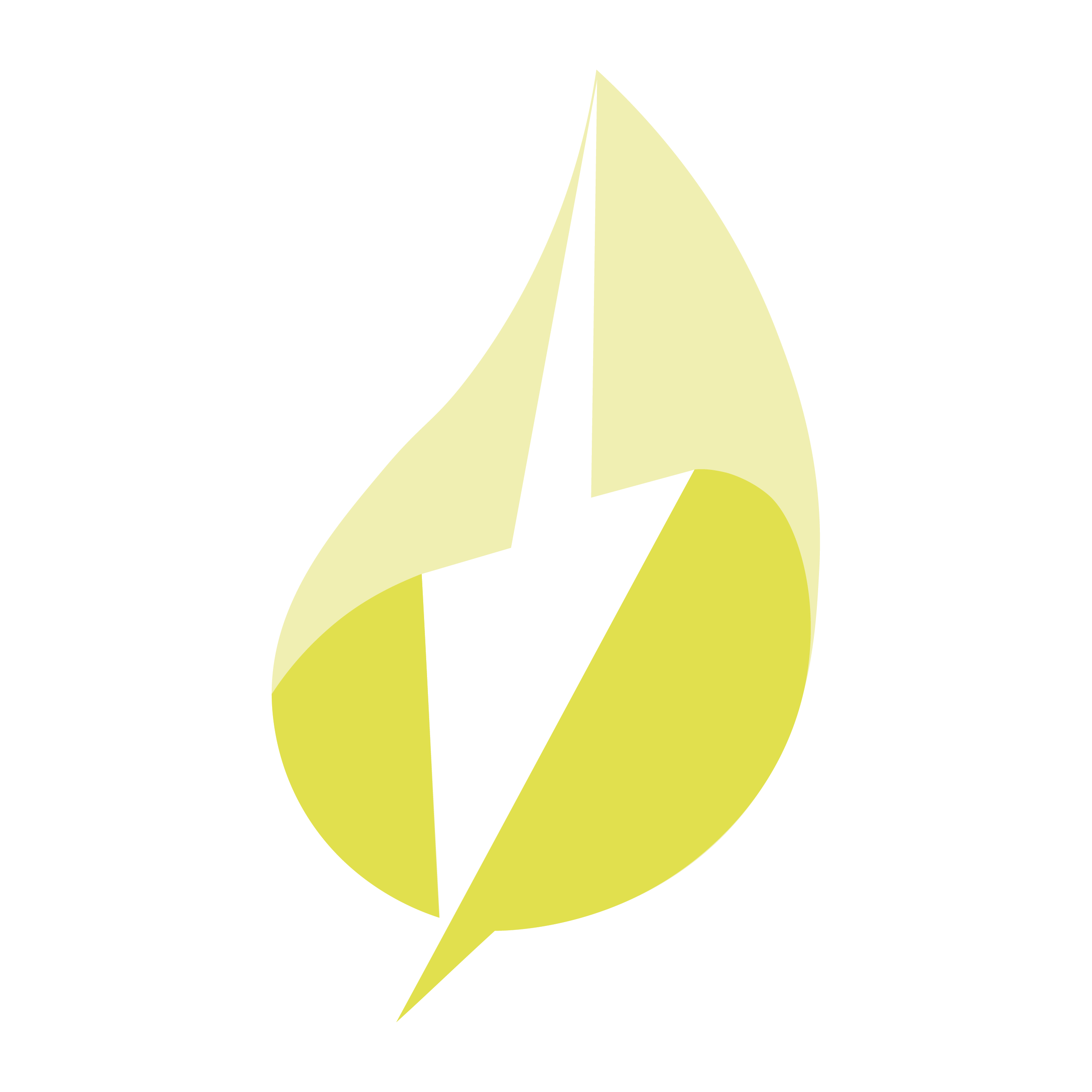Alors que la révolution de la mobilité électrique s’accélère en Europe, les micro‑États — Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint‑Marin et Vatican — présentent des dynamiques singulières. Bien que leurs populations soient réduites, ces États font face à des défis spécifiques en matière d’électromobilité. On peut citer infrastructures, incitations, changement de flotte, et contraintes géographiques.

Une dynamique européenne plus large
En Europe, le marché automobile progresse de 10 % en septembre 2025, avec 888 672 immatriculations. Les véhicules électriques représentent 18,9 % des ventes sur le mois, soit 167 586 unités. Sur neuf mois, leur part atteint 16,1 %, en hausse de 24,1 % par rapport à 2024. Cependant, ce rythme reste insuffisant pour la transition énergétique, selon l’ACEA. Toutefois, cet indicateur masque des disparités importantes entre pays et surtout entre la « taille » des États.
Les micro-États échappent souvent à une visibilité claire dans les statistiques européennes. Néanmoins, l’infrastructure publique de recharge connaît une accélération notable depuis le déploiement du règlement AFIR, en vigueur depuis avril 2024. En mai 2025, l’Union européenne comptait près de 970 000 points de recharge publics, soit une hausse de près de 40 % en un an. Pourtant, 40 % de ces bornes se concentrent encore aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, accentuant les déséquilibres régionaux. L’objectif européen reste ambitieux : disposer de bornes rapides d’au moins 400 kW tous les 60 km d’ici à 2026 sur les grands axes. En conséquence, même les petits États doivent désormais combler leurs retards structurels. Ils devront s’intégrer dans ce réseau harmonisé à l’échelle du continent.
Monaco : le pionnier urbain
Le cas de la Principauté de Monaco est particulièrement documenté. Le réseau « Monaco ON », lancé en 2020, vise à déployer des bornes gratuites et accessibles dans l’ensemble du territoire. À la fin de 2023, les véhicules « propres » (électriques ou hybrides) représentaient déjà près de 16 % du parc total. On pouvait compter environ 7,6 % de véhicules 100 % électriques.
En 2024, les données indiquent un total « écologique » de 40,3 % pour la période. Les incitations sont nombreuses : subvention à l’achat (jusqu’à 30 % du prix, plafonnée), rechargement public gratuit, stationnement de rue gratuit pour VE, vignette annuelle gratuite.
Malgré tout, Monaco doit encore faire face à des enjeux. On compte déjà le coût élevé des véhicules électriques dans un parc très haut de gamme. Ainsi que la dépendance à l’importation d’électricité et l’optimisation de l’usage des bornes. Cependant, le modèle monégasque prouve que même un micro‑État peut progresser rapidement lorsqu’il conjugue incitations, infrastructure et politique cohérente.

Andorre : une montée discrète mais tangible
Dans la principauté d’Andorre, bien que les données précises sur le parc électrique global soient limitées, plusieurs indicateurs montrent un progrès réel. Le pays comptait 87 stations de recharge publiques recensées à fin 2024, pour un territoire de 468 km². Le nombre d’heures‑mégawatts consommées sur les bornes publiques a augmenté de 128 à 464 MWh entre 2020 et 2024, soit +262 % en quatre ans. De plus, certains tarifs publics encourageaient les VE via les deux premières heures gratuites dans les zones de transit. Toutefois, on dispose de peu de données sur la part de marché des VE dans les immatriculations ou dans le parc roulant. Le double objectif pour Andorre est donc : renforcer la statistique, mais aussi stimuler l’adoption via incitations nouvelles et extension de l’infrastructure.
Liechtenstein : modeste mais en mouvement
Le Liechtenstein, petit État alpin, affiche aussi une adoption encore modeste. À fin juin 2023, les voitures 100 % électriques représentaient environ 4 % du parc automobile total. Pour les immatriculations de véhicules neufs, en mars 2025, sur 134 voitures enregistrées, 23 étaient entièrement électriques. Les mesures d’incitation sont limitées : pas de subvention nationale pour les VE en 2025, mais exemption de la taxe annuelle pour VE et certaines municipalités offrent le stationnement gratuit. L’infrastructure propose aujourd’hui environ 56 bornes publiques à travers le pays. L’enjeu principal est d’augmenter la visibilité des VE et de développer l’offre d’infrastructures rapides pour encourager les acheteurs potentiels.
Saint‑Marin et le Vatican : des données trop limitées
Pour les deux autres micro-États — la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican — les données publiques sur les véhicules électriques demeurent limitées ou partielles. Cette rareté s’explique par leur très petite taille, la faiblesse du nombre d’immatriculations et l’absence d’obligation de publication de statistiques détaillées.
À Saint-Marin, le projet E-Way illustre toutefois une volonté politique claire de promouvoir une mobilité plus durable. Le territoire dispose de 22 bornes de recharge pour voitures électriques, chacune équipée de deux prises de 11 kW et 22 kW, ainsi que de six bornes dédiées aux vélos électriques. Ces installations, fournies par ABB, permettent une recharge complète en moins d’une heure et sont compatibles avec la majorité des modèles du marché, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Cette infrastructure, encore modeste, marque une étape importante vers l’adoption d’une mobilité à faible impact environnemental au sein de la République.

De son côté, le Vatican a récemment franchi une étape symbolique dans sa transition vers des transports respectueux de l’environnement. Le Gouvernorat de la Cité a lancé, en collaboration avec Exelentia, une nouvelle flotte de véhicules électriques destinée aux services internes et aux déplacements dans les Villas pontificales de Castel Gandolfo. Ces véhicules, allant des utilitaires aux navettes pour visiteurs, équipent désormais la Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers et les équipes de maintenance. Cette initiative illustre l’engagement croissant du Saint-Siège à réduire son empreinte carbone et à promouvoir une mobilité zéro émission dans ses espaces symboliques. Le Vatican avait annoncé en 2020 un grand plan de remplacement de ses véhicules.
Malgré ces avancées, l’adoption des véhicules électriques à Saint-Marin comme au Vatican demeure encore limitée, faute d’un parc civil significatif et de données consolidées permettant de mesurer précisément leur diffusion.
Vers quels enjeux pour ces micro‑États ?
D’une part, la taille réduite de ces territoires constitue un avantage potentiel : une norme, un réseau, une politique peuvent être mis en œuvre plus rapidement qu’à l’échelle nationale. D’autre part, les obstacles sont spécifiques : dépendance des importations d’énergie ou infrastructures, marchés d’achat très petits qui limitent les économies d’échelle, et enjeux de stationnement ou d’habitat (notamment pour les résidents sans garage). Le développement des bornes rapides ou ultra‑rapides reste encore peu documenté pour ces États. En outre, si l’on projette que l’Europe dans son ensemble devra installer jusqu’à 3,5 millions de bornes d’ici à 2030 pour soutenir l’électromobilité, les micro‑États ne sont pas exemptés de l’effort. Enfin, le suivi statistique reste une lacune qu’il serait urgent de combler pour suivre finement l’évolution des parts de marché, notamment pour Saint‑Marin ou le Vatican.
Un potentiel sous‑exploité mais en marche
En bref, les micro‑États européens montrent des trajectoires variées. Monaco apparaît comme un modèle parmi les plus avancés dans cette catégorie. Andorre démontre un bon rythme de progression infrastructurelle, tandis que Liechtenstein progresse, mais reste à un stade d’adoption modeste. Saint‑Marin et le Vatican restent en marge faute de données.
Pour tous, les défis sont désormais clairs. Il faut augmenter les incitations et renforcer le réseau de bornes de recharge. Il est aussi essentiel de simplifier l’adoption des véhicules électriques et d’améliorer le suivi des indicateurs. Dans un contexte européen en pleine accélération, ces petits États disposent d’une réelle opportunité. Mais ils ont aussi la responsabilité de ne pas rester à la traîne.